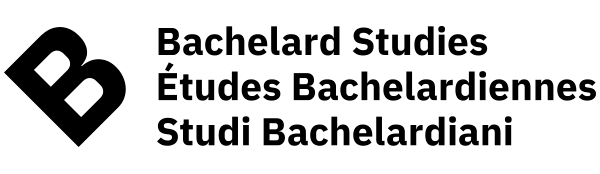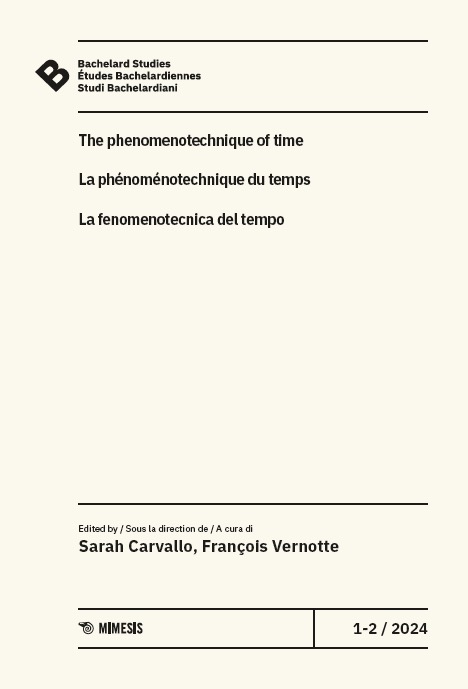Abstract
In questo articolo mostriamo come le due grandi rivoluzioni della fisica teorica del xx secolo – la fisica quantistica e la relatività generale – abbiano plasmato i nostri sistemi di riferimento spazio-temporali moderni e le loro realizzazioni. Da una parte, lo sviluppo della fisica quantistica ha permesso l’invenzione degli orologi atomici e di collegare il secondo, l’unità di tempo fisico, a una grandezza fisica postulata come universale: una frequenza di transizione dell’atomo di cesio. Dall’altra parte, la relatività generale ha permesso di sviluppare il quadro concettuale in cui collegare le durate misurate da un insieme di orologi con un tempo-coordinata globale, la cui realizzazione consente l’istituzione delle scale temporali internazionali. Mostreremo anche come la costruzione e la materializzazione dei riferimenti spazio-temporali possano inscriversi in un’interpretazione bachelardiana attraverso il concetto di fenomenotecnica. Il legame tra le misure degli orologi e le scale temporali internazionali dipende da un modello geometrico dello spazio-tempo. Per stabilire un accordo sulle scale temporali internazionali, alcuni organismi internazionali hanno definito i modelli geometrici convenzionali dello spazio-tempo, definendo implicitamente i riferimenti spazio-temporali convenzionali. Questi organismi sono Union Astronomique Internationale (UAI) e il Bureau International des Poids et Mesures (BIPM).
Così, il quadro concettuale dei riferimenti spazio-temporali, elaborato a partire dalle teorie fisiche, si materializza grazie a un insieme di misure di tempo o di frequenza che seguono protocolli sperimentali ben documentati e convenzioni internazionali. L’accordo tra queste misure e le previsioni delle misure calcolate entro il quadro concettuale ci informa che il nostro quadro concettuale è una “buona” descrizione della realtà. Lo studio di questo accordo costituisce l’oggetto della metrologia. Tuttavia, accade spesso che le nostre misure non corrispondano alle previsioni, il che conferisce alla metrologia un potere euristico, e può portare alla scoperta di una nuova legge fisica, a una migliore descrizione dei nostri strumenti di misura e delle nostre procedure sperimentali, o addirittura a rimettere in discussione il quadro concettuale e quindi la teoria fisica che gli è sottesa. Descriveremo due esempi di questo approccio euristico metrologico: l’esperimento storico del pendolo degli astronomi e il suo equivalente moderno degli orologi atomici.